Du franc Poincaré au » franc fort » des années 1980
Le siècle des dévaluations
Dans le cadre du cycle de conférences données par Le Comité pour l’histoire économique et financière de la France au MINEFI intitulé « Les Français et leur monnaie : le louis, le franc, l’euro et les autres » (voir les NBB n° 221 et 222), la cinquième conférence retrace l’histoire tourmentée des dix-sept dévaluations du franc intervenues au XX ème siècle.
Cet article est issu de la conférence de M. Jean-Charles Asselain, professeur à l’Université de Bordeaux IV, donnée au MINEFI le 4 février 2002.
Les monnaies heureuses n’ont pas d’histoire, disait Alain Plessis, à propos du XIXème siècle. Au XXème siècle, au contraire, le franc a une histoire, une histoire tourmentée, qui est l’histoire de ses dix-sept dévaluations. Si l’on regarde côte à côte la pièce de vingt francs-or qui circulait encore à la veille de la guerre de 1914 (bien qu’elle fût à l’effigie de Marianne, son contenu en or restait celui du » napoléon » : la valeur du franc n’avait pas changé depuis la loi de germinal et l’Empire) et sa lointaine descendante, la pièce de vingt centimes – vingt » anciens francs » – qui vit ses derniers jours en ce mois de février 2002, les deux pièces se ressemblent, Marianne n’a pas vieilli, la couleur de la pièce de vingt centimes fait de son mieux pour rappeler l’or, sa taille est un peu plus grande, son poids un peu plus léger. Mais l’or a fait place à un vil alliage, et notre Marianne de 20 centimes vaut deux mille fois moins que la pièce de 20 francs-or (qui se négocie pour quelque 60 euros, ou 400 francs). Le franc avait donc perdu 99,95% de sa valeur de 1914. D’autres calculs plus significatifs peut-être confirment tous cet ordre de grandeur. Une somme prêtée sans intérêt en 1914, et qui aurait donc conservé sa valeur nominale par-delà le passage au » nouveau franc « , aurait donc perdu aujourd’hui plus de 99,9% de sa valeur réelle, de son pouvoir d’achat de 1914.
Rien d’étonnant dès lors si les Français, tout au long du siècle, ont beaucoup soupiré après leur monnaie. » Qu’il est devenu léger, notre pauvre franc ! [….] Ce dernier demi-sou qui nous reste est à la mesure de nos malheurs : il paie deux invasions et trente années de vicissitudes « , écrivait au lendemain de la dévaluation de décembre 1945 le chroniqueur de La vie française, René Sédillot. De pareils gémissements avaient accueilli en 1928 le » franc de quatre sous » de Raymond Poincaré : le franc, devenu inconvertible depuis 1914, venait alors de retrouver sa convertibilité en or, mais avec une parité-or réduite au cinquième de celle du franc germinal ( 1/5ème de vingt sous : le franc de 4 sous). Et la même génération connaîtra encore bien des dévaluations, chacune invariablement ressentie par le grand public comme une amputation de la richesse nationale dans la même proportion : raisonnement bien simpliste, diront les économistes, mais peu importe…. En fait, la récurrence des dévaluations n’aura jamais suffi à les banaliser totalement. Jacques Attali lui-même, après la mini-dévaluation de 1982, parle d’ » humiliation » pour le gouvernement, alors que ce n’est pourtant ni la première, ni la dernière dévaluation du septennat.
Abordée sous cet angle, l’histoire monétaire de la France au XXème siècle se raconte sur le ton de la nostalgie : A la recherche du franc perdu… Ce ne peut être que l’histoire du long calvaire du franc. Ou, si on préfère un vocabulaire moins émotionnel, l’histoire de son affaiblissement cumulatif – en termes de pouvoir d’achat, de valeur-or et aussi de taux de change vis-à-vis des devises étrangères. Car non seulement la valeur réelle du franc diminue, en ce siècle inflationniste, mais elle diminue plus que celle du dollar, de la livre, du mark ; d’où la dépréciation du change, toujours douloureuse pour l’amour propre national.
Mais ce n’est point ce lamento qui constituera l’axe directeur de ma communication. J’ai d’ailleurs cherché à corriger le pessimisme du titre – le siècle des dévaluations – par un sous-titre plus tonique – du franc Poincaré au » franc fort » des années 1980. Je voudrais aussi montrer que l’adage : » La santé d’une monnaie reflète la force de l’économie » n’est en réalité qu’une fausse évidence. Dans le cas de la France, en tout cas, il y a un décalage frappant entre le redressement de l’économie française, qui s’amorce dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, et le redressement du franc, beaucoup plus tardif ; car c’est la dévaluation réussie de décembre 1958 qui, en consolidant la position extérieure de l’économie française parallèlement au rétablissement des équilibres internes, annonce et préfigure le franc fort des années 1980. En somme, il s’agit de comprendre comment, paradoxalement, de dévaluation en dévaluation, le franc a pu s’acheminer vers le retour à un statut de monnaie forte. Montrer que toutes les dévaluations ne se ressemblent pas et que certaines d’entre elles ont pu jouer un rôle éminemment positif n’a bien entendu rien à voir avec une quelconque réhabilitation du laxisme monétaire contre le franc fort.
Un franc qui rétrécit toujours ….
L’amaigrissement du franc se poursuit tout au long du XXème siècle. Ce processus, dont nous chercherons à prendre la mesure, se présente sous un double visage :
– au plan interne, c’est l’érosion quasi continue du pouvoir d’achat du franc en biens et services – autrement dit l’inflation.
– au plan international, c’est la dépréciation du franc, autrement dit la diminution de sa valeur en or ou en devises étrangères. Elle intervient le plus souvent au XXème siècle par une décision discontinue des autorités monétaires, en changes fixes, et on parle alors de dévaluation.
▪ Inflation et dépréciation externe sont étroitement liées
À long terme, le taux de change tend nécessairement à refléter l’évolution du pouvoir d’achat interne de la monnaie, selon la relation tout à fait intuitive dite de Parité de Pouvoir d’Achat (PPA). Un pays plus inflationniste que ses partenaires est voué à subir une détérioration du change, car le refus de dévaluer serait synonyme de monnaie surévaluée, de prix excessifs et de perte de compétitivité, d’où un déficit extérieur intenable à long terme. La dévaluation peut donc être considérée comme la sanction d’une forte inflation. Mais il s’agit d’une relation à double sens. Car la dévaluation exerce à son tour un double effet inflationniste : un effet mécanique par le renchérissement des importations, et des effets indirects encore plus puissants, à travers les anticipations et les processus d’indexation. On risque alors d’assister à un processus cumulatif d’inflation-dépréciation, où le pays à forte inflation n’est pas seulement sanctionné par une détérioration du change » une fois pour toutes « , mais aussi durablement maintenu sur une trajectoire inflationniste. Toute la question est alors de savoir comment sortir de ce cercle vicieux. Par une dévaluation dont on maîtrise les conséquences inflationnistes ? Ou par un refus volontariste de dévaluer, mais alors, comment échapper à un déséquilibre extérieur intenable ? C’est là, je crois, exprimé dans les termes les plus simples, le dilemme quasi permanent, ou du moins récurrent, auquel est confrontée la politique du franc au XXème siècle.
▪ Le constat de l’affaiblissement cumulatif du franc au XXème siècle – » un franc qui rétrécit toujours » –
Plaçons-nous du point de vue de sa valeur internationale, tout en gardant présente à l’esprit la relation étroite avec l’inflation interne.
De l’évolution entre 1913 et 1983 de la valeur du franc par rapport au dollar ainsi que par rapport aux principales monnaies européennes et au yen, trois faits marquants se détachent:
-
le franc s’est massivement déprécié vis-à-vis du dollar à travers l’ensemble du siècle : il perd 99,3 % de sa valeur en soixante-dix ans (le taux de dépréciation calculé de 1913 à aujourd’hui serait d’ailleurs quasiment le même);
-
cette dépréciation a eu lieu pour l’essentiel lors des deux guerres mondiales et des deux immédiats après-guerres;
-
le franc s’est aussi déprécié vis-à-vis de la plupart des monnaies européennes (sauf la lire italienne), quoique dans une proportion en général plus faible (sauf à l’égard du mark, si l’on met à part l’hyper-inflation de 1922-1923). On remarque aussi, par la même occasion, la disparité de destin séculaire entre les trois principales monnaies aujourd’hui » fondues » dans l’euro.
L’évolution de la parité-or du franc, devenue d’ailleurs de plus en plus théorique jusqu’à la fin du système de changes fixes en 1973, présente un profil tout à fait semblable à celui du taux de change franc contre dollar. Il vaut la peine cependant de remarquer que, si les dévaluations (ou » grappes de dévaluations « , comme on le précisera dans un instant) se succèdent selon un rythme quasi décennal durant la plus grande partie du siècle, leur amplitude tend à diminuer après 1949 (voir tableau 1).
Tableau 1
Profil temporel de la dépréciation du franc au cours du XXème siècle
(Calculé d’après la parité-or du franc à la fin de chaque décennie.)
| Période |
Date des dévaluations |
Taux de dévaluation/dépréciation |
| 1914-1929 |
1928 |
– 79,7 % |
| 1929-1939 |
1936-1939 |
– 58 % |
| 1939-1949 |
1945-1949 |
– 89,7 % |
| 1949-1959 |
1958 |
– 29,1 % |
| 1959-1969 |
1969 |
– 11,1 % |
Cette tendance à l’amortissement du rythme de dépréciation se poursuit après 1969, comme on le verra à propos des » mini-dévaluations » des années 1980, et l’on a déjà relevé que la parité franc-dollar est presque la même fin 1983 et aujourd’hui.
▪ Les objections liées au mark
À ces comparaisons axées sur l’or ou le dollar, il peut être objecté qu’à partir des années 1970, le mark a remplacé l’or et le dollar comme » point fixe » des relations monétaires en Europe. » Alors que le dollar se promène au gré de la spéculation internationale, remarquent en 1985 A. Fonteneau et P.-A. Muet dans La gauche face à la crise, en s’appréciant de plus de 100 % sans soulever plus d’émotion qu’un vulgaire bulletin météorologique, le moindre ajustement de la parité franco-allemande fait figure de défaite nationale « . Cette polarisation sur le taux de change vis-à-vis du mark a sans doute quelque chose d’excessif, puisqu’elle revient à considérer comme négligeables toutes les autres relations extérieures de la France, ce qui est manifestement exagéré. Le fait est pourtant que toute une série de raisons – l’intensification des échanges franco-allemands, les progrès de la construction européenne, le prestige du mark en tant que » monnaie forte » par excellence – se conjuguent pour conférer un rôle pivot à la parité franc-mark. Or son évolution fait apparaître une tendance presque régulière à la dépréciation du franc, qui persiste cette fois jusqu’en 1986-1987 (voir tableau 2).
Tableau 2
Rythme décennal de dépréciation du franc vis-à-vis du mark
| Période |
Variation (en %) de la parité du franc |
| 1949 – 1959 |
– 28, 8 % |
| 1959 – 1969 |
– 25,7 % |
| 1969 – 1979 |
– 33,9 % |
| 1979 – 1989 |
– 30 % |
| 1989 – 2001 |
0 |
▪ La conclusion d’une tendance à la consolidation relative du franc n’est cependant pas complètement infirmée
D’abord parce que, même vis-à-vis du mark, la dépréciation du franc en cette seconde moitié du XXème siècle apparaît plus modérée que vis-à-vis de l’or ou du dollar dans la première moitié du siècle. De plus, le mark représente une référence particulièrement ambitieuse, puisqu’il s’agit durant toute cette période d’une monnaie forte en voie de réévaluation systématique. Et cela rend d’autant plus remarquable la stabilité sans précédent de la parité avec le mark maintenue à partir de 1987, soit déjà une douzaine d’années avant la fixation irrévocable des parités au sein de la zone euro.
Faut-il voir là une soudaine mutation des années 1980, l’avènement du franc fort ? Ou peut-on en trouver les prémices dans l’histoire des dévaluations du franc qui se sont succédé jusqu’aux années 1980 ?
La ronde des dévaluations : chacune a son visage….
De 1928 aux années 1980, comme on vient de le voir, les dévaluations semblent obéir en France à une sorte de rythme décennal. Mais cette régularité ne signifie pas que les événements se répètent : cette seconde partie visera au contraire à montrer la diversité des expériences de dévaluation.
Il n’est pas question bien entendu de passer en revue, une par une, les dix-sept dévaluations du franc qui ont eu lieu de 1928 à 1986. Le comptage précis n’a d’ailleurs aucun sens, en raison des nombreux cas-limites d’opérations hybrides ou de dévaluations par étapes. En revanche, la chronologie suffit à faire apparaître un clivage dominant entre des dévaluations » réussies « , effectuées » une fois pour toutes « , entendons par là des dévaluations qui parviennent à assurer au moins quelques années de consolidation monétaire, et des dévaluations qui » bégaient » (1936-1940, 1945-1949, 1981-1983), c’est-à-dire des dévaluations en grappe ou en cascade, où l’abaissement de la parité du franc est aussitôt interprété comme l’annonce de nouveaux glissements à venir, avec les effets négatifs qu’on imagine.
La dévaluation de 1928 : la » der des der » ?
Parmi les dévaluations réussies, une place à part revient à la première de toutes, celle que Poincaré opère en 1928 et qui, pour les contemporains, aurait dû être – comme la guerre de 1914 – la » der des der « . Elle ne le fut pas, et pourtant, malgré cette déception, elle demeure le modèle, le succès exemplaire dont on s’inspire notamment en 1958.
Pour comprendre les enjeux, il faut rappeler d’abord qu’en 1914, les Français ont derrière eux plus d’un siècle de stabilité monétaire. Le franc germinal a résisté aux guerres, aux invasions, aux défaites de 1814, 1815, 1871, et bien entendu à toutes les révolutions et changements de régime. Il serait impensable que la France victorieuse de 1918 soit incapable de rendre au franc » sa » valeur-or (l’idée même est presque aussi incongrue que de penser à réduire les distances en faisant varier la définition du kilomètre…).
Il faut rappeler ensuite la séquence particulièrement heurtée des événements monétaires jusqu’en 1926-1928, marquée par de tels retournements que la loi monétaire de 1928 peut être qualifiée soit de stabilisation (mettant fin à la crise), soit de revalorisation (par rapport à la dépréciation maximale enregistrée lors de la crise), soit de dévaluation (par rapport à la parité d’avant-guerre). À l’origine, en effet, il y a le choc financier de la guerre, qui provoque des déséquilibres financiers littéralement sans précédent. Là-dessus intervient cette crispation des Français sur le retour à l’ancienne parité, qui exclut la recherche d’un nouvel ancrage; le franc est condamné à » flotter » jusqu’au » retour à la normale « . En conséquence se développe la crise du franc flottant, qui s’amplifie d’elle même jusqu’en 1926 : tout recul du franc sur le marché des changes relance l’inflation et provoque de nouvelles anticipations de baisse, de nature auto-réalisatrice. Enfin, à l’été 1926, on assiste au » miracle Poincaré » : la crise se dénoue, la spéculation s’inverse, le franc remonte aussi vigoureusement qu’il avait chuté. En fait, le miracle Poincaré ne mérite pas son nom : il s’explique par l’effet même de l’inflation, qui a considérablement allégé le poids réel de la dette, par le changement de majorité à droite qui rétablit la confiance des possédants (les économistes d’aujourd’hui évoquent la » crédibilité » de Poincaré), et par l’excès même de la dépréciation du franc, qui facilite sa remontée par un effet de rebond.
Ce qui nous amène très précisément à la stabilisation-dévaluation de 1926-1928. Une dévaluation hors-série, qui correspond non pas à un abandon de la parité en vigueur imposée par une pression à la baisse sur le marché des changes, mais au contraire à une intervention délibérée pour contenir la remontée du franc (décembre 1926), suivie dix-huit mois plus tard par la décision prise à froid de renoncer définitivement à une revalorisation plus poussée du franc. Malgré ces traits singuliers, le choix crucial, comme dans les dévaluations » ordinaires « , est celui du taux de dévaluation. En acceptant – à contrecœur – une dévaluation très forte (amputation des 4 / 5 è), Poincaré assure à l’économie française un double avantage. Un avantage de compétitivité commerciale. Et un avantage encore plus net à l’égard des mouvements de capitaux : le franc est jugé sous-évalué, les capitaux peuvent donc venir (ou revenir) s’investir en France en toute sécurité. La conclusion est paradoxale au regard des idées reçues. Le franc en 1928 est à la fois une monnaie (fortement) dévaluée, une monnaie (modérément) sous-évaluée, et en même temps il est d’un seul coup redevenu une monnaie forte – notamment face à la livre sterling, héroïquement réévaluée à son ancienne parité au nom d’une logique de monnaie forte, mais qui apparaît en réalité surévaluée, fragile et menacée. Les Français, qui ont difficilement renoncé à tout espoir de retour à la parité d’avant-guerre en se résignant au » franc de 4 sous « , ont du moins de bonnes raisons d’espérer que cette dévaluation effectuée pour solde de tout compte ne sera suivie d’aucune autre. Et c’est malheureusement cette confiance retrouvée qui sera à l’origine des nouveaux malheurs du franc dans les années 1930.
1936-1940 : dévaluations en cascade, le franc à la dérive
La dévaluation de 1936 présente trois différences marquantes avec celle de 1928. Elle fait suite à des événements monétaires internationaux – dévaluation de la livre en 1931, puis du dollar en 1933 – plutôt qu’à des déséquilibres internes. Elle intervient dans le cadre d’un accord monétaire international avec la Grande Bretagne et les Etats-Unis, préfigurant de loin la coopération monétaire d’après 1945. Enfin et surtout, malgré ces conditions favorables, c’est un échec patent, comme en témoignent les dévaluations à répétition qui se succèdent jusqu’à la guerre.
À quoi tient cet échec ? L’expérience des années 1930 illustre avant tout les risques d’une dévaluation trop tardive. Les Français, comme en 1918, sont au départ presque unanimes dans leur obstination à rejeter toute nouvelle dévaluation, convaincus que le franc est redevenu pour toujours une monnaie forte ; et ils ne s’aperçoivent pas que cette monnaie forte est en voie de devenir à son tour une monnaie surévaluée, donc une monnaie de plus en plus menacée, à la fois par un déficit commercial en croissance explosive et par les sorties de capitaux, dont l’accélération en1936 s’explique aussi par des motifs politiques. La dévaluation de 1936 peut également être qualifiée de trop tardive en ce sens qu’une fois l’opération reconnue inéluctable par le gouvernement Blum, il la repousse encore jusqu’au moment où, à l’automne, il est contraint de dévaluer en catastrophe.
Une seconde raison de l’échec, c’est le taux insuffisant de la dévaluation, qui d’ailleurs ne la rend pas moins impopulaire pour autant. Ce faible taux est la contrepartie d’une dévaluation négociée avec les partenaires étrangers : le rapprochement avec les années 1980 est intéressant à cet égard.
Enfin, la troisième raison majeure de l’échec réside dans le contexte inflationniste où intervient la dévaluation. Même une dévaluation plus énergique n’aurait procuré qu’un court répit face à la hausse des prix et des salaires en plein élan depuis l’été 1936. Avant même le creusement du déficit commercial, c’est la reprise des sorties de capitaux qui signale l’échec de la dévaluation : le maintien de la nouvelle parité (ou plus exactement le maintien du taux de change dans l’intervalle fixé par la loi monétaire) a été presque aussitôt jugé peu crédible. Et à partir de là, la dépréciation s’accentue d’elle même jusqu’à la fin de 1938, selon des mécanismes semblables à la crise du franc des années 1920. Ainsi, la politique monétaire volontariste maintenue jusqu’en 1936 aura été sanctionnée à la fois par l’incapacité de l’économie française à émerger de la crise et, en fin de compte, par une dépréciation inouïe en pleine paix, vis-à-vis non seulement de l’or, mais aussi des monnaies précocement dévaluées, comme la livre et le dollar.
Si cette sombre période peut être créditée d’un rôle positif, c’est à titre d’ » anti-modèle » – de repoussoir -, à travers les réflexions qu’elle inspire à de futurs responsables de l’après-guerre, comme Pierre Mendès France ou Jacques Rueff.
1944-1949 : les dévaluations du franc faible, une normalisation inachevée
La période de l’immédiat après-guerre est une période passionnante, mais extrêmement complexe, qui justifierait une conférence à elle seule. Il faudra donc se limiter à quelques traits saillants.
Le second après-guerre est, comme le premier, une période fortement inflationniste, pour des raisons fondamentalement assez analogues, mais cette inflation se déroule dans un contexte de changes fixes (et non plus de changes flottants, comme lors de la crise du franc des années 1920) et elle atteint en fin de compte des proportions encore plus dramatiques. Ce qui peut être relié à trois caractéristiques spécifiques de ce second après-guerre en France:
– la monnaie est sacrifiée, délibérément ou presque, aux priorités de la Reconstruction et du redressement économique. Toute idée de retour à la parité d’avant-guerre est cette fois radicalement écartée ; le financement des investissements par la création monétaire est considéré comme un mal nécessaire;
– l’ajustement de la valeur externe du franc s’effectue avec un retard systématique sur sa dévalorisation interne. Il en résulte donc une tendance systématique à la surévaluation du franc, qui est plus ou moins corrigée au lendemain de chaque dévaluation, mais qui tend aussitôt à reparaître;
– face à la contrainte extérieure, l’État recourt à des instruments de régulation directe. Le franc est inconvertible : inconvertible non plus seulement en or, mais aussi – à la différence des années 1920 – en devises étrangères. Il existe un contrôle des changes qui s’applique aux mouvements de capitaux, mais aussi aux transactions commerciales, à travers le contingentement des importations. Cette situation persiste pour l’essentiel jusqu’en 1958, qui correspond à la fois à l’entrée en vigueur du Traité de Rome et à l’avènement de la Vème République.
1958 : de nouveau, l’ultime dévaluation
C’est en 1958 que, pour la première fois depuis 1928, on a pu croire venue l’heure d’un véritable » retour à la normale « .
L’année 1958 a connu, en fait, deux dévaluations, celle de juin et celle de décembre. Celle de juin n’est que la régularisation d’une dévaluation camouflée opérée sous la IVème République en 1957, et elle vise seulement à améliorer l’équilibre extérieur en effaçant le différentiel d’inflation accumulé depuis 1949. Cet objectif est du reste atteint dans l’immédiat, avec la réalisation d’un quasi-équilibre de la balance commerciale au dernier trimestre de 1958.
Mais c’est la dévaluation de décembre 1958 qui revêt une tout autre portée, parce qu’elle s’insère dans un plan d’ensemble de redressement de l’économie française, le plan Rueff-de Gaulle. Le rapprochement entre décembre 1958 et la stabilisation Poincaré de 1926-1928, à bien des égards, s’impose de lui-même. Une dizaine d’années après la fin des hostilités, il s’agit de maîtriser et de solder les conséquences monétaires de la guerre. Dans les deux cas, la crise des finances publiques est à l’origine d’une rupture politique majeure. Dans les deux cas, la volonté d’un homme d’Etat parvient à dominer le cours des événements, et ce retournement est ressenti comme un miracle. En 1926 comme en 1958, les travaux d’un comité d’experts ont contribué à dégager un consensus et à définir les solutions.
Mais, comme toujours, on doit se garder de forcer le parallèle. La personnalité de Jacques Rueff, la force de ses convictions libérales, ses réflexions mûries de longue date confèrent au plan Rueff de 1958 beaucoup plus de cohérence que n’en avait l’action de Poincaré en 1926, et les relations personnelles de confiance que Rueff a su établir avec le général de Gaulle lui ont permis d’en imposer l’application intégrale contre les tentations de compromis et de demi-mesures. Les rythmes non plus ne sont pas les mêmes : la progression à marche forcée de l’automne 1958 contraste avec les atermoiements de Poincaré en 1926-1928. Enfin, les objectifs sont plus larges : il ne s’agit pas seulement d’assainir les finances publiques, mais d’éradiquer l’inflation, d’éliminer les indexations, de rétablir la vérité des prix et de stimuler l’investissement productif afin de rendre possible la réouverture de l’économie française.
Nous ne chercherons pas ici à présenter une fois de plus le plan Rueff et son application, mais il y a lieu de s’interroger sur le point qui, paradoxalement, pose problème : l’insertion de la dévaluation dans ce dispositif. Car l’opportunité d’une (seconde) dévaluation n’était a priori nullement évidente, et l’on peut même s’étonner d’un tel choix, peu conforme à première vue aux engagements de stabilité monétaire et à l’esprit volontariste du programme de redressement. De plus, il n’y avait pas péril en la demeure, compte tenu du soulagement apporté par la dévaluation de juin, et il semble que l’initiative soit venue de Roger Goetze et du gouverneur Wilfrid Baumgartner, plutôt que de Jacques Rueff. Mais on sait aussi que Rueff, après avoir intégré la dévaluation dans » son » plan, en a défendu le principe avec la dernière énergie, notamment contre son ministre, Antoine Pinay. La raison en est claire : il s’agissait de renforcer la position des industriels français au seuil du Marché Commun, à la fois directement en termes de compétitivité-prix, et indirectement en leur donnant plus de moyens pour investir. 1958 représentait à cet égard une occasion exceptionnelle à saisir, tant du point de vue du contexte international que du rapport des forces politiques internes, qui rendait possible un déplacement du partage entre salaires et profits à l’avantage des entreprises.
Les résultats ont été largement à la hauteur des attentes. La dévaluation de décembre 1958 ouvre immédiatement la voie au rétablissement de la convertibilité du franc vis-à-vis du dollar, à la libération des échanges avec les partenaires européens (objectif qui, depuis des années, paraissait inaccessible) et à l’application du Traité de Rome selon le calendrier prévu : à cet égard, le redressement français de 1958 doit être considéré comme un jalon majeur de la construction européenne. L’expérience démontre aussi qu’une dévaluation n’a pas nécessairement un effet inflationniste – puisque la hausse des prix demeure en 1958 nettement inférieure aux prévisions – et que le déficit extérieur n’est jamais une fatalité : la France va durant plusieurs années enregistrer des excédents extérieurs, qui lui permettent de reconstituer rapidement ses réserves de change. On reviendra dans la dernière partie sur les mécanismes et la portée de ce redressement. Mais il est clair que l’instrument ne devait jamais plus servir à l’avenir : la dévaluation de décembre 1958 devait être la dernière de toutes. La création du nouveau franc, aux yeux du général de Gaulle, symbolisait avec force cet engagement de stabilité monétaire.
L’engagement, comme on sait, fut tenu jusqu’au moment de son départ. Mais non au – delà : la dévaluation de 1969 fut la suite quasi immédiate de l’élection de Pompidou.
1969 : la dévaluation contestée
Si l’espace réservé à chaque dévaluation devait être proportionnel à son intensité, la dévaluation de 1969 n’aurait droit qu’à un bref paragraphe, puisque son taux de 11,1 % est nettement plus faible que celui de toutes les dévaluations antérieures.
Mais elle mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle présente quelques singularités remarquables et pose plusieurs questions encore controversées.
La première singularité est qu’on peut lui assigner une origine directe clairement identifiée : le choc salarial de mai-juin 1968 et son impact sur l’équilibre extérieur de la France, alors que le différentiel d’inflation avec les partenaires de la France était presque éliminé les années précédentes.
La seconde singularité est que cette dévaluation a donné lieu à une série de rebondissements dramatiques. Le 13 novembre 1968, face aux menaces sur la tenue du franc, le général de Gaulle déclare en Conseil des ministres que dévaluer serait la pire absurdité : mais le seul résultat est d’attiser la spéculation. Une semaine plus tard, le général de Gaulle est apparemment résigné à l’inéluctable dévaluation, avec les déchirements que l’on peut imaginer. Mais, dans les heures décisives qui précèdent le Conseil des ministres du 23 novembre, les adversaires de la dévaluation, Raymond Barre, Roger Goetze, Jean-Marcel Jeanneney surtout – les » hommes de 1958 » – parviennent à emporter la conviction du général de Gaulle : la dévaluation serait un double reniement, à l’égard des propos qu’il a tenus quelques jours plus tôt et, plus fondamentalement, à l’égard de ses engagements de 1958 ; la dévaluation doit et peut être évitée. L’après-midi du 23 novembre, le Conseil des ministres, à l’issue d’un débat mouvementé, rejette la dévaluation et lui substitue un plan de lutte contre l’inflation. Les Français approuvent selon le témoignage des sondages. L’épisode aura montré à quel point la dévaluation reste la hantise de l’opinion.
Mais la dévaluation écartée en novembre 1968 aura lieu finalement neuf mois plus tard, en août 1969, quelques semaines après l’élection de Georges Pompidou. Était-elle inéluctable ? Apparemment oui, à en juger par l’épuisement rapide des réserves de change accumulées en neuf ans depuis 1958, qui ont presque totalement fondu en un an. Mais on peut soutenir que l’absence de convictions fermement opposées à la dévaluation de la part du nouveau Président ne pouvait échapper aux spéculateurs et qu’elle est en partie responsable de l’accélération des sorties de capitaux au printemps 1969.
En tout cas, l’opération a été menée énergiquement et accompagnée d’un plan de mesures contre l’inflation. Et les résultats ressemblent étrangement à ceux de 1958 : amélioration quasi immédiate de la balance commerciale, reconstitution spectaculaire des réserves d’or et devises, accélération sans précédent de la croissance et des investissements – on y reviendra à propos des mécanismes de cheminement vers le franc fort. Pourtant, ce succès reste contesté : selon ses adversaires, la dévaluation de 1969 est responsable de l’accélération de l’inflation et on doit aussi lui faire grief d’avoir habitué les exportateurs français à compter sur la sous-évaluation du franc. En fait, la question essentielle est de savoir comment les industriels ont réussi à préserver durablement, au moins jusqu’en 1973, la faible marge de compétitivité que leur avait procurée une dévaluation au taux très modéré de 11,1%. La réponse tient en grande partie à un facteur exogène : vers 1970, l’inflation mondiale en pleine accélération a pratiquement rejoint le rythme de l’inflation française ; et ceci montre bien à quel point la tenue du franc est désormais dominée par des facteurs internationaux que la France ne contrôle pas.
1981, 1982, 1983 : trois mini-dévaluations sur le chemin du franc fort
Nous allons maintenant franchir d’un bond les changes flottants des années 1970 (le franc se déprécie, mais il n’y a pas à proprement parler de dévaluation en changes flottants), nous franchissons l’instauration de la politique de rigueur par Raymond Barre et l’entrée du franc dans le SME en 1979, et nous atteignons les trois dévaluations » jumelles » (ou triplées) de 1981, 1982, 1983 qui font presque figure d’ultimes péripéties sur le chemin du franc fort. À quoi tient l’importance de ces trois mini-dévaluations, dont les taux respectifs s’étagent de 2,5 à 5,5% seulement ?
La réponse se fera en deux temps, en évoquant le sentiment d’échec qu’elles engendrent, puis la clarification qui en résulte finalement.
Sentiment d’échec d’abord. Cette fois, c’est le rapprochement avec le Front Populaire qui surgit inévitablement. En 1981 comme en 1936, l’arrivée au pouvoir de la gauche a été saluée par de violentes sorties de capitaux. En 1981 comme en 1936, on a manqué l’occasion d’une dévaluation immédiate qui aurait pu être présentée comme l’apurement de la gestion passée. Ensuite, pendant deux ans, une série de demi-mesures et de fausses manœuvres renforcent cette impression de maladresse. On peut voir là un coût d’apprentissage du pouvoir. Mais, pour l’opinion, les échecs monétaires viennent aussitôt après l’aggravation du chômage dans les raisons du mécontentement et de la désaffection dont témoignent les sondages, puis les élections partielles et municipales. Il est clair qu’une dévaluation forte, mais unique aurait été incomparablement moins traumatisante que trois mini-dévaluations subies et ressenties comme un signe d’impuissance. Mais la possibilité d’une solution alternative existait-elle réellement ? et si oui, laquelle ?
Ce qui conduit au second point : la clarification de 1983. Il est clair que le fonctionnement du SME ne laisse place qu’à des ajustements négociés, de faible amplitude, insuffisants pour effacer durablement un différentiel d’inflation tel que celui qui existe alors entre la France et ses partenaires. Il n’y a donc que deux voies possibles. L’une, que ses partenaires appellent » l’autre politique » faute d’entente sur une formulation plus précise, consisterait à sortir du SME et à laisser le franc flottant se déprécier fortement pour freiner les importations et soutenir en France le développement industriel et l’emploi. L’autre consiste au contraire à maintenir et renforcer l’engagement européen, en accentuant la politique de rigueur pour échapper à l’humiliation des dévaluations répétées. Le moment de vérité est intervenu en mars 1983, il correspond précisément à la dernière des trois dévaluations. Le choix de rester dans le SME est sans ambiguïté. La politique de rigueur est désormais présentée non plus comme un renoncement temporaire aux objectifs de 1981, imposé par la contrainte extérieure, mais comme l’instrument d’une action volontariste au service d’une double ambition : la modernisation industrielle et la construction de l’Europe.
Le franc fort pourra bien être paré après coup de toutes les vertus : discipline anti-inflationniste, baisse des taux d’intérêt, condition d’une croissance soutenue et du renforcement structurel. Mais il est d’abord en réalité une implication directe du choix de l’Europe.
Sous les dévaluations, le franc fort
Au terme de ce survol historique, pouvons-nous dégager de l’expérience des dévaluations du franc certaines constantes ? et pouvons-nous dégager une dynamique d’évolution ?
La première constante est que les dévaluations ont toujours eu mauvaise presse. Mais toutes ne méritent pas leur mauvaise réputation, toutes ne justifient pas les soupçons qui pèsent sur elles a priori. Car si certaines dévaluations ne sont effectivement que de simples jalons du processus d’amenuisement du franc, si parfois même un second ajustement qui les suit à brève échéance (en 1937, en 1948, en 1982) est aussitôt perçu comme le prélude à une nouvelle amputation, d’autres en revanche peuvent se comparer à une opération chirurgicale réussie; l’entrée en convalescence – au sens économique, financier et politique – est souvent presque immédiate. La dévaluation apparaît alors comme un nouveau départ; A. Prate ne craint pas de comparer le franc à un arbre que l’on taille, empruntant au Bocage royal de Ronsard l’image poétique du saule verdissant : « Plus on le coupe et plus il est naissant / Et rejetonne en branches davantage / Prenant vigueur de son propre dommage ».
En termes moins lyriques, l’analyse des effets d’une dévaluation doit toujours se situer à l’intersection du monétaire et de l’économique. Plusieurs visions dominantes – radicalement divergentes ou même opposées – de leurs relations respectives se sont succédé au cours du XXème siècle : au lendemain de la Première Guerre mondiale, le primat inconditionnel au rétablissement de la monnaie; lors du second après-guerre, au contraire, et bien plus durablement, le sacrifice inévitable de la monnaie au redressement de l’économie; plus tard encore, la notion d’un arbitrage entre stabilité de la monnaie et vigueur de la croissance. Depuis un quart de siècle, en revanche, la conception qui tend à s’imposer est que cet arbitrage n’existe pas, et qu’une » monnaie forte » est la condition d’une croissance durable. D’une mise en perspective historique, on ne saurait attendre qu’elle suffise pour trancher dans l’absolu entre ces thèses opposées. Certaines conclusions paraissent néanmoins se dégager clairement.
L’enseignement le plus net de l’expérience historique est un enseignement négatif, le caractère préjudiciable des dévaluations trop tardives (ou insuffisantes, ou l’un et l’autre à la fois), et cela quels que soient les motifs qui poussent à temporiser. La France, dans des contextes très divers, a vu se répéter à plusieurs reprises au cours du siècle la même séquence : l’avantage d’une » monnaie forte « , que l’on évoque comme une source de prestige et fierté, se transforme insensiblement en crispation sur une parité surévaluée, qui doit être artificiellement » défendue « , sans parvenir pour autant à écarter la menace latente de dévaluation.
Le second après-guerre, toutefois, n’entre pas exactement dans ce schéma général, bien que les gouvernements de l’époque aient, eux aussi, cherché à repousser au maximum la dévaluation que chacun sait inéluctable. Mais l’originalité de cette période réside dans des conditions institutionnelles qui tendent à isoler au maximum l’économie française du reste du monde, à l’instar des économies de type soviétique : inconvertibilité, contrôle des changes s’appliquant même aux transactions courantes, régulation directe des flux commerciaux. La contrainte extérieure n’est certes pas éliminée (la France n’a jamais été aussi dépendante de l’extérieur), mais elle s’exerce à travers la répartition autoritaire des ressources en devises, et non plus à travers l’influence des prix relatifs. À l’abri de l’écran ainsi constitué vis-à-vis de l’extérieur, les autorités ont utilisé la latitude d’action dont elles disposaient pour mener une politique expansionniste, mettant la création monétaire au service des investissements publics. Cette stratégie peut être créditée d’avoir mis en place les bases de la Reconstruction et de la modernisation. Etait-elle pour autant la seule possible ? Le contre-exemple de l’Italie ou de l’Allemagne incite à répondre résolument par la négative. En tout cas, on commence en France dès la fin des années 1940 à prendre conscience des menaces graves qu’une telle politique fait peser sur l’épargne (effet dissuasif des taux d’intérêt réels négatifs) et sur l’incitation à exporter (méfaits d’une parité surévaluée), et les mesures de 1947-1949, tout en restant à mi-chemin, annoncent déjà le sens des ajustements ultérieurs.
▪ L’expérience des déséquilibres de la première moitié du XXème siècle a-t-elle été prise en compte dans la période récente ?
Implicitement oui, avec la mise en place de ce qu’on pourrait appeler une régulation par les dévaluations. Les données fondamentales sont simples et varient peu, de la Seconde Guerre mondiale aux années 1980. L’économie française demeure en général plus inflationniste que la majorité des autres pays industrialisés. En changes fixes, sa compétitivité-prix tend à se dégrader. Le correctif le plus simple réside dans les dévaluations périodiques : chacune a pour fonction d’ »effacer » l’effet cumulé du différentiel d’inflation depuis l’ajustement précédent. La dévaluation se banalise ; elle n’est plus une opération chirurgicale risquée, mais tend à devenir la thérapie d’une déficience chronique. Compte tenu de l’ouverture croissante de l’économie française, une surévaluation du franc d’intensité comparable à celle des années 1940 serait insupportable, même à titre temporaire ; d’où le recours à des dévaluations de faible amplitude, mais parfois à intervalle rapproché, comme dans les années 1980.
Ce schéma simplifié, cependant, représente tout au plus l’esquisse d’une » trajectoire » de long terme. Car la dévaluation n’a jamais été totalement banalisée, elle n’a jamais totalement perdu son caractère traumatisant, pour des raisons en partie objectives (certains intérêts sont lésés, tout comme en cas de réévaluation, et ils s’expriment plus fort que les bénéficiaires) et en partie subjectives : la dévaluation reste ressentie par l’opinion comme un appauvrissement, et par les gouvernants comme un échec. D’où la tendance persistante, comme on vient de le souligner, à retarder les dévaluations, non sans conséquences fâcheuses. S’il n’en résulte pas toujours des pertes directement visibles en termes de parts de marché, c’est souvent, dans un contexte de forte concurrence, au prix d’un sacrifice des marges des exportateurs, qui réduit leur capacité d’investissement et de modernisation, et qui risque par là même d’affaiblir structurellement à terme la position concurrentielle des secteurs d’exportation ( » compétitivité hors-prix « ). La régulation par les dévaluations apparaît donc comme un palliatif imparfait. Et l’on pourra se demander, arrivé à ce point de l’analyse, comment il a pu être question d’un arbitrage entre davantage de croissance et une meilleure tenue de la monnaie : n’y a-t-il pas complémentarité plutôt que concurrence entre ces deux objectifs ?
▪ Dans certains contextes historiques, une dévaluation énergique a pu agir comme catalyseur de la croissance, bien au-delà d’une impulsion de court terme
Pour le montrer, il y a lieu de revenir sur les dévaluations de 1958 et 1969. Elles ont en commun d’intervenir l’une et l’autre à un stade critique de la construction européenne, de procurer à l’économie française un avantage durable de compétitivité et de mettre en mouvement des mécanismes de renforcement de la croissance industrielle. Du point de vue de la compétitivité, il était essentiel d’abord que le taux de la dévaluation ne soit pas calculé au plus juste pour effacer simplement une surévaluation antérieure du franc, et ensuite de faire en sorte que la marge de compétitivité ainsi créée ne soit pas aussitôt érodée par l’inflation. Cette double condition a été remplie en 1958 et en 1969. Mais 1958 et 1969 se ressemblent encore davantage par les mécanismes mis en jeu. Dans les deux cas, la dévaluation et son plan d’accompagnement agissent sur la répartition, dans le sens d’un renforcement de la part des profits ; d’où l’essor des investissements productifs (stimulés conjointement par tout un faisceau de mesures d’incitation), l’accélération des gains de productivité et l’élargissement des parts de marché, qui deviennent au moins autant affaire de compétitivité structurelle que de compétitivité-prix. En somme, un cercle vertueux de croissance. Une partie de ces interactions positives était intervenue déjà au cours des années 1920, soit pendant la phase de forte croissance industrielle stimulée par la dépréciation du franc jusqu’en 1926, soit pendant la phase de consolidation qui correspond à la » stabilisation Poincaré « . Mais la portée historique des succès de 1958 et 1969 tient aussi à leur dimension européenne, sans équivalent dans les années 1920. En quinze ans de mutation industrielle accélérée, la France aura réussi à passer d’un commerce extérieur encore à forte composante coloniale vers 1958 à une structure d’échanges essentiellement tournée vers l’Europe dès le début des années 1970.
▪ L’histoire du franc au XXème siècle s’inscrit en réalité dans un double mouvement inverse de dislocation monétaire mondiale et de construction monétaire européenne
Il est à peine nécessaire de rappeler que l’histoire monétaire du XXème siècle commence avec la guerre de 1914, qui provoque l’effondrement de l’étalon-or. Les dévaluations en ordre dispersé des années 1930, l’isolement des économies nationales à l’abri du contrôle des changes conduisent à un cloisonnement sans précédent de l’espace monétaire mondial et de l’économie mondiale. Plus tard, la rupture de 1973 inaugure une nouvelle phase d’instabilité des monnaies. Le franc, quant à lui, n’influence que marginalement l’évolution mondiale Mais il en subit de plein fouet l’impact, accusant une perte de valeur particulièrement violente de 1919 à 1926, de 1936 à 1949, de 1974 à 1978.
En revanche, le franc, ou la France, se trouve activement impliqué à toutes les étapes de la construction d’une Europe monétaire. On relève à plusieurs reprises une coïncidence non fortuite entre les dévaluations du franc et des tournants importants de l’histoire européenne. En septembre 1936, l’accord tripartite entre la France, la Grande Bretagne et les États-Unis a surtout une valeur symbolique. En septembre 1939, le réalignement général des monnaies européennes – dont le franc français – à la suite de la dévaluation de la livre a déjà une signification bien plus considérable. Contrairement aux stabilisations en déséquilibre du premier après-guerre, effectuées au coup par coup hors de toute coordination, il instaure un ensemble de parités suffisamment cohérent pour permettre à l’Union européenne des Paiements (créée en 1950) de fonctionner sur cette base pendant huit ans. Quant à la dévaluation de décembre 1958, elle n’est pas seulement un tournant majeur pour la France, mais pour l’Europe, dans la mesure précisément où la faiblesse du franc français bloquait tout progrès, à commencer par le rétablissement de la convertibilité des monnaies européennes. Au-delà de l’épisode de 1958, le redressement du franc, jalonné par les dévaluations de 1958 et 1969, et le renforcement de la position industrielle de la France constituaient un enjeu décisif du point de vue des équilibres européens. Lorsque survient la tourmente des changes flottants, le resserrement des liens de toute nature entre les économies des six nations fondatrices est déjà un fait accompli. La pression qui s’exerce pour imposer de facto la stabilité des taux de change, avec convergence des taux d’inflation, en découle directement. Et le chemin parcouru par la France de 1983 à 1993 confirme, après les expériences de 1958 et 1969, qu’il n’y a pas de » fatalité » du différentiel d’inflation ; il préfigure ce qu’accompliront un peu plus tard d’autres pays réputés congénitalement inflationnistes, comme l’Italie ou l’Espagne.
Quant à notre franc, si souvent malade au cours du XXème siècle, on peut dire, au moment où il disparaît en se fondant définitivement dans l’euro, que le patient est mort guéri.
© Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie – 19/02/2002
 Partager sur facebook
Partager sur facebook

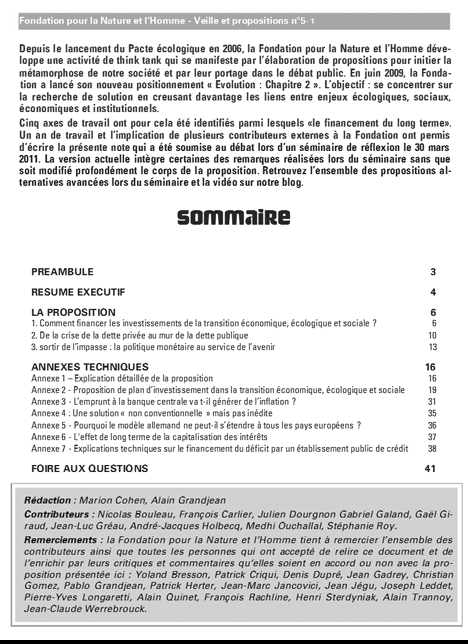
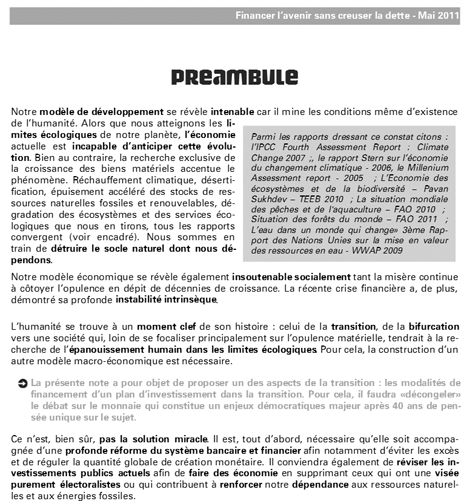
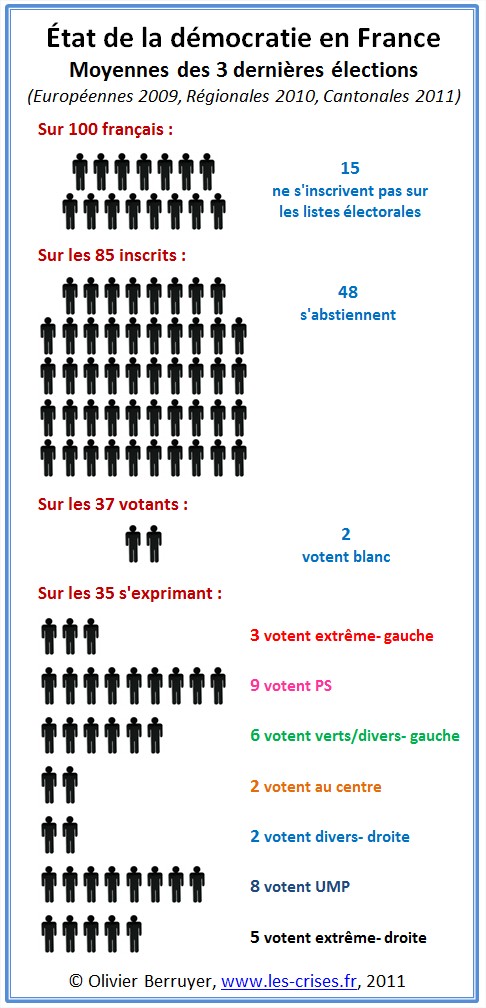
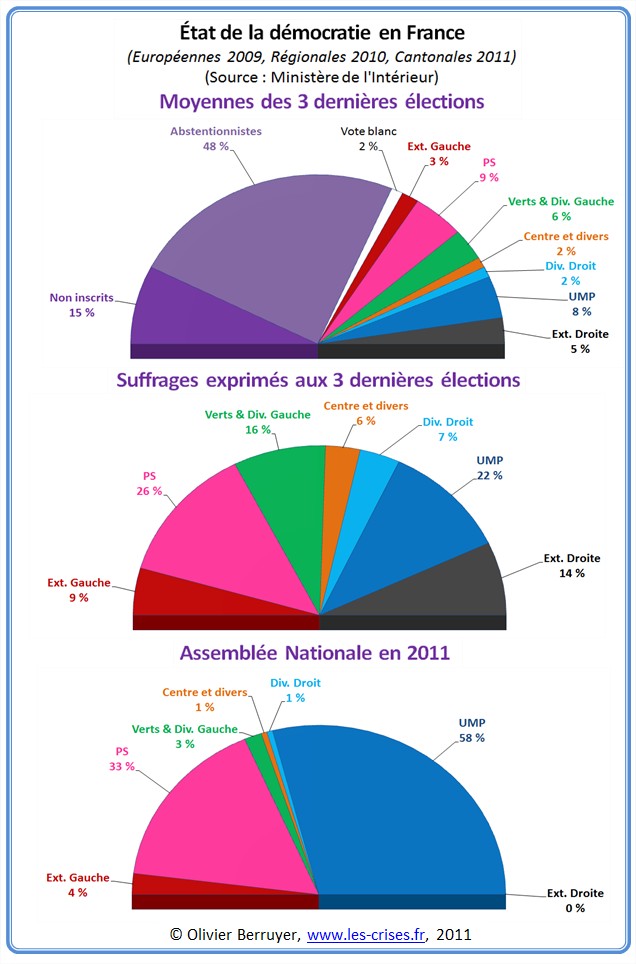
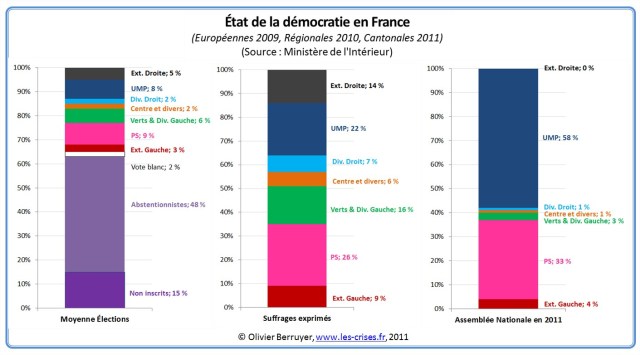

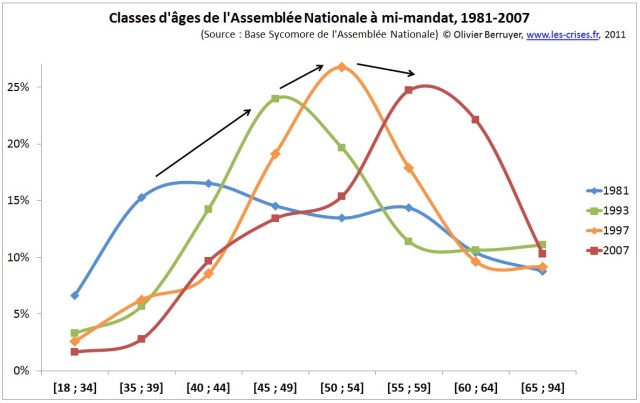
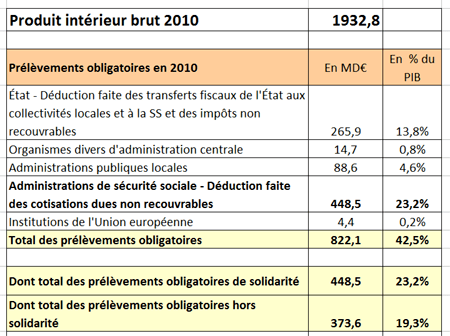
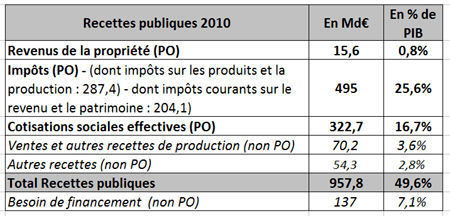
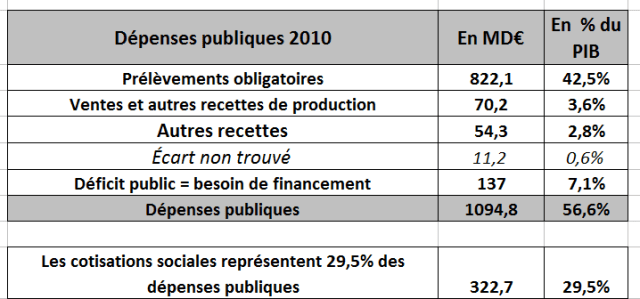
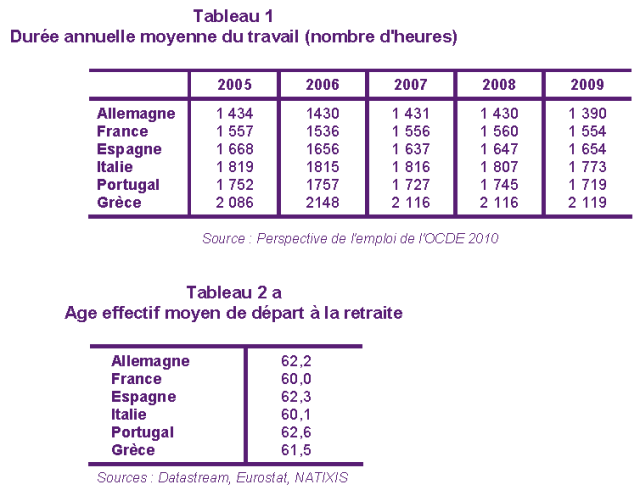
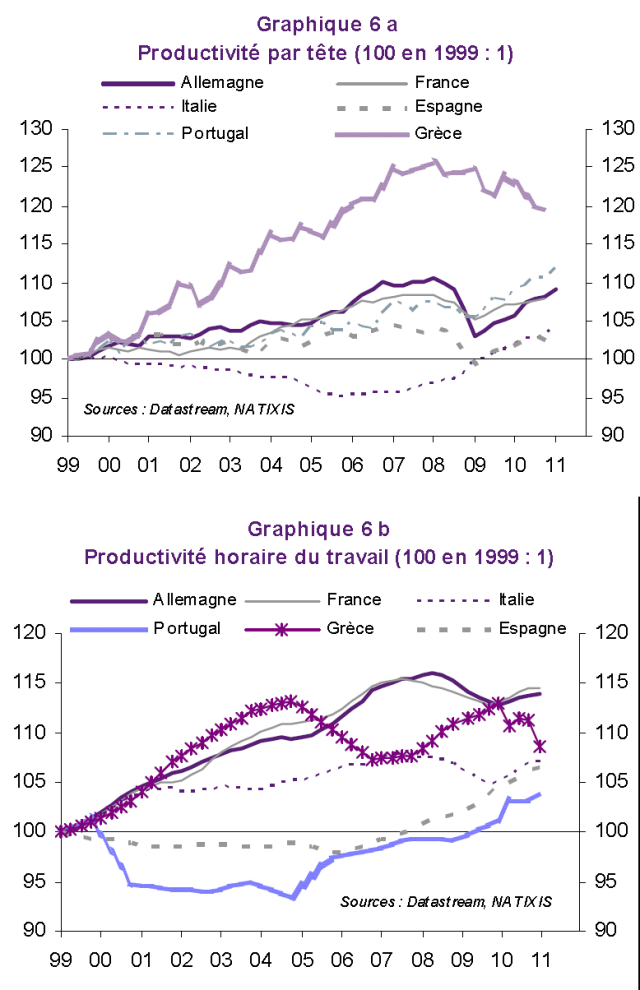

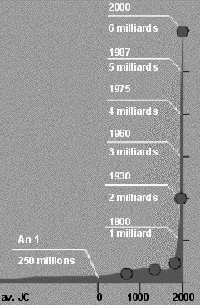
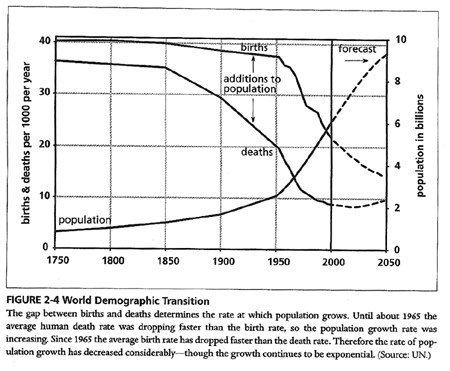
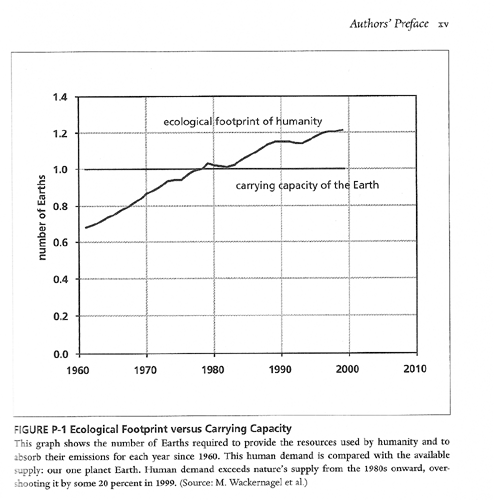
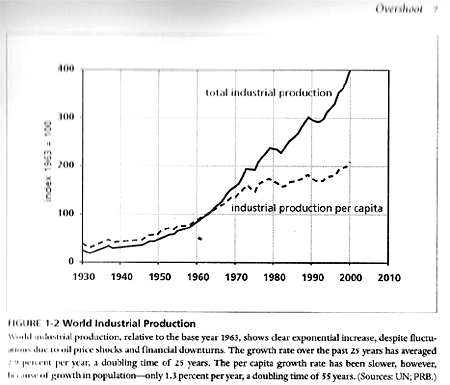
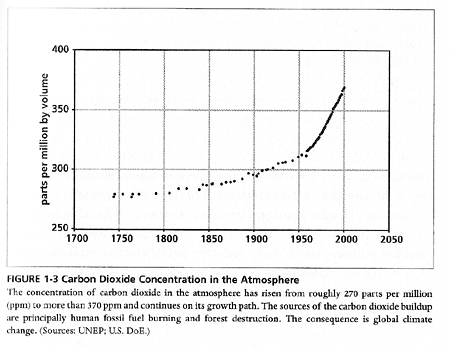
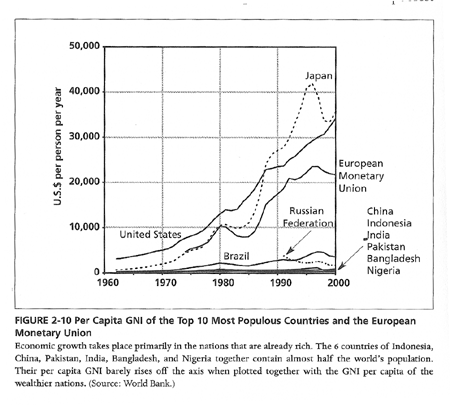
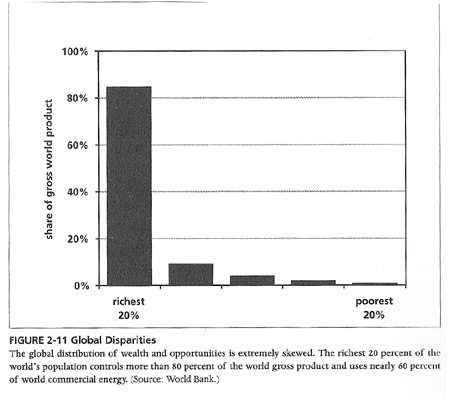
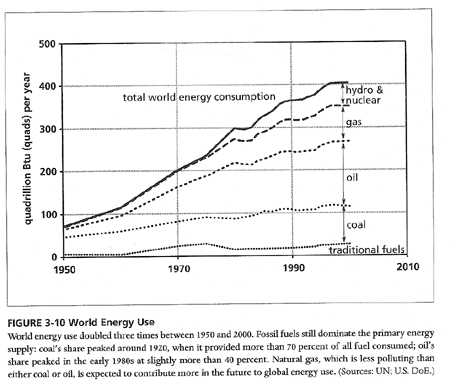

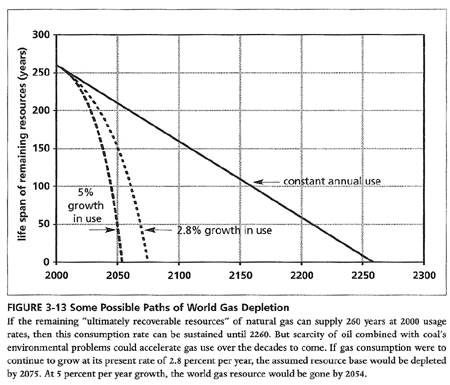
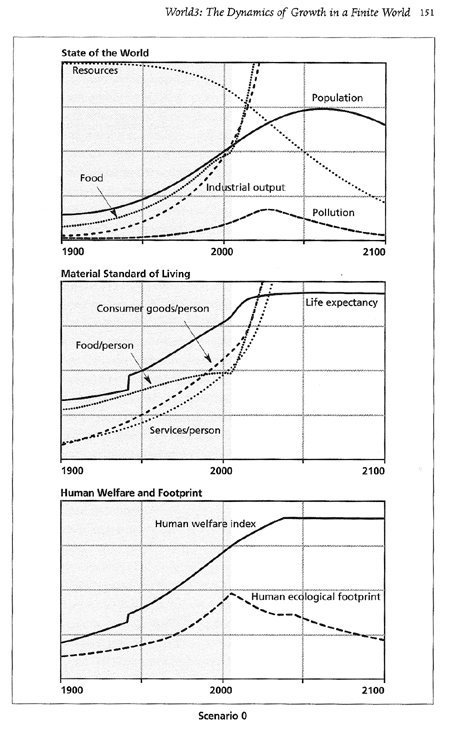
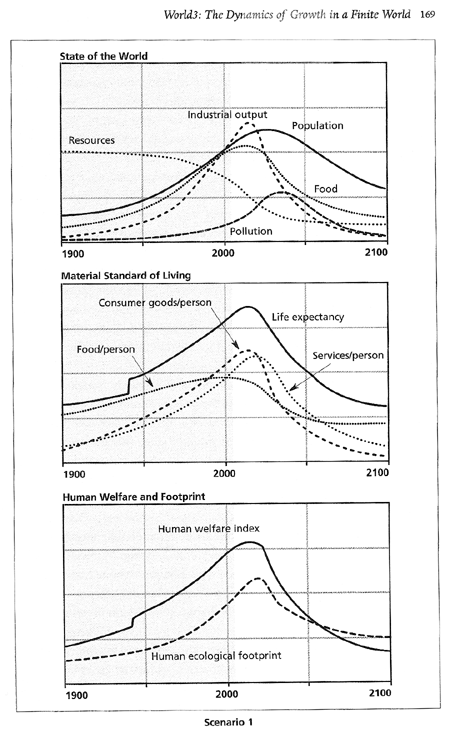
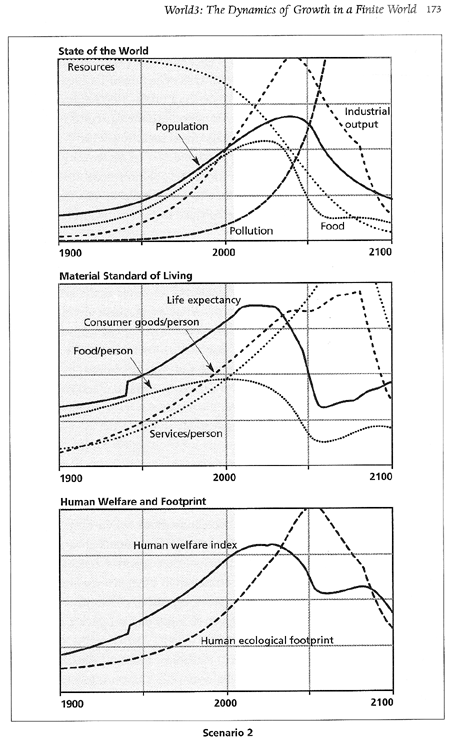
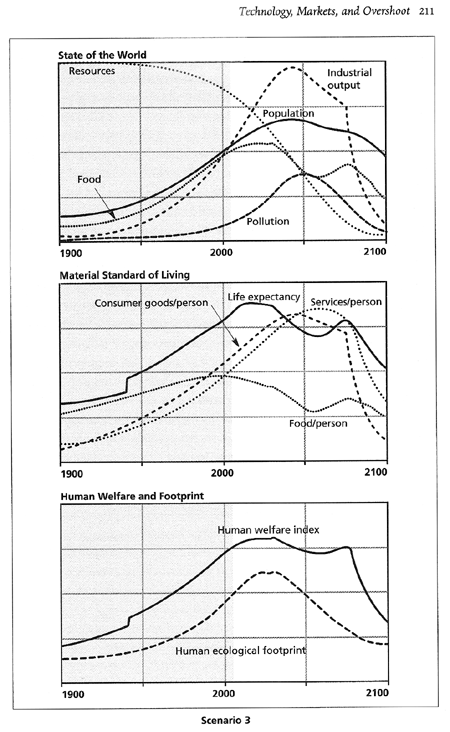


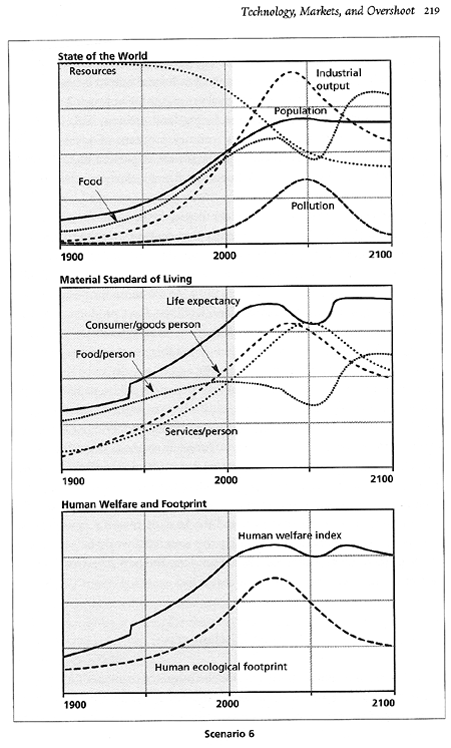
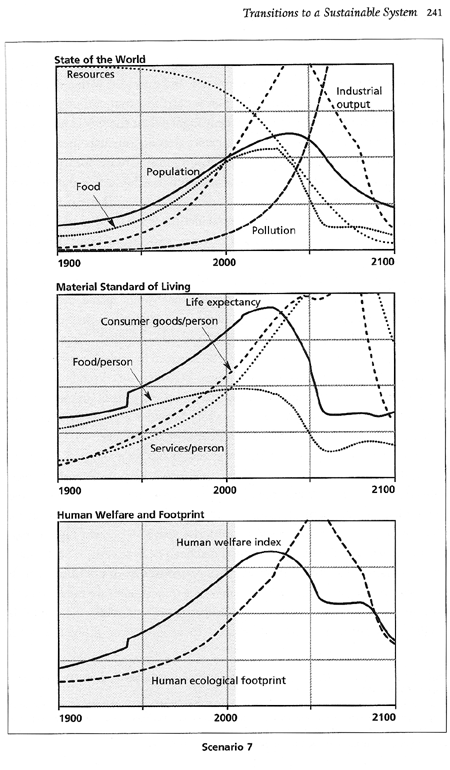
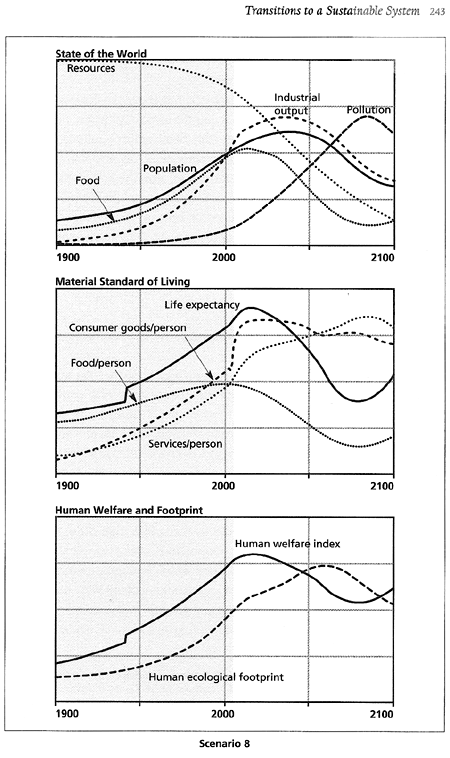

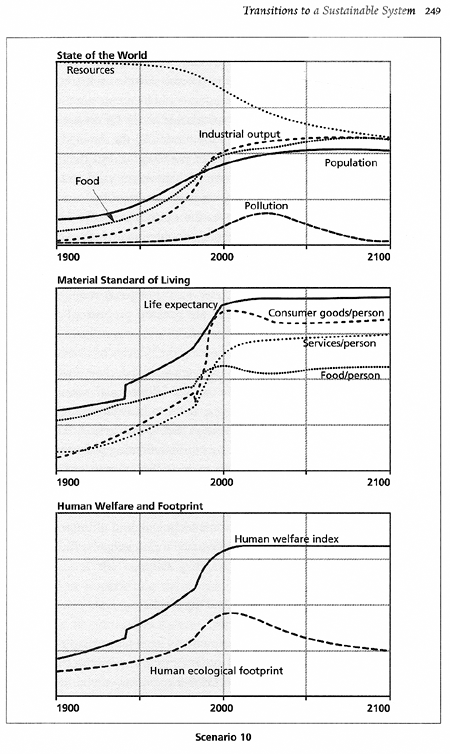
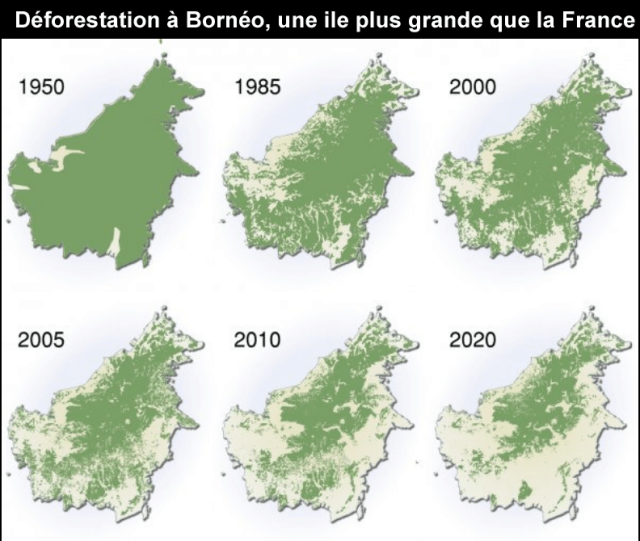
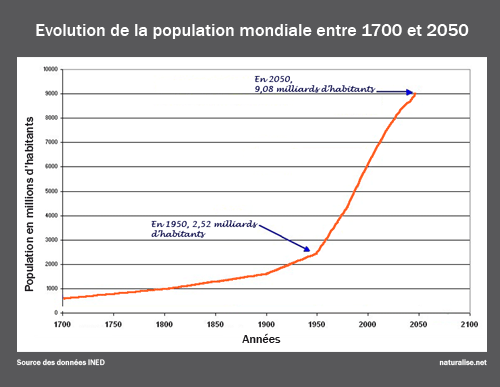
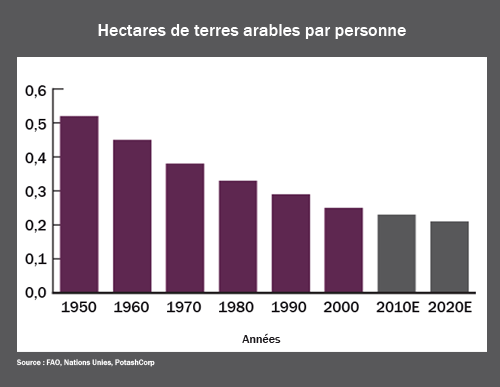


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.